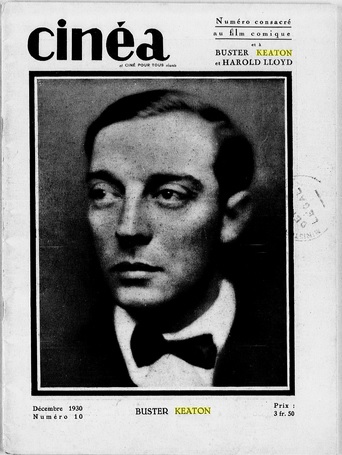Le 21 Mars 1895, le quotidien Gil Blas informe ses lecteurs que son collaborateur Maurice Beaubourg part le soir même pour la Tunisie et l'Algérie. Beaubourg s'est fait un nom dès 1890 avec les Les Contes pour les assassins préfacé par Maurice Barrès. La publication des Nouvelles Passionnées (1893) et la représentation de L'image en 1894 l'ont installé dans les milieux symbolistes. Maurice Beaubourg avait donné en 1893 au même quotidien sous forme de feuilleton son exquise nouvelle Une saison au bois de Boulogne où à la manière des Liaisons dangeureuses, l'auteur narre les aventures d'une bande de souteneurs et de leurs filles partis se mettre au vert dans le bois parisien.
La maison se propose de donner les articles écrits par Maurice Beaubourg et publiés par Gil Blas dans le cadre de son séjour en Afrique du Nord (à notre connaissance, cette série n'a jamais été publiée en volume).
A Tunis, pendant les dernières nuits du Ramadan, au quartier arabe de Bab-Souika, toute l'étroite rue d'Alfa-Houin flamboie. Le soir, trois coups de canon ont résonné, délivrant les fidèles du jeûne sévère du jour. Et les voilà tous maintenant qui vont vers les petites boutiques illuminées, parmi les lanternes multicolores des marchands d'oranges, de dattes, de piments, de nougats, de sucreries, de fritures, tandis qu'au-dessus d'eux les minarets étincelants des mosquées de Sidi Mah'rez et de Sahab et Tabadji fleurissent leurs girandoles dans les étoiles.
Durant les sept derniers soirs de ce jeûne de Ramadan, c'est ainsi fête à l'étroit faubourg d'Alfa-Houin. A travers les portes ouvertes, derrière les rideaux flottants qui dissimulent les spectacles, nasillent et crient les flûtes monotones, scandées du bruit des tam-tams, des tambourins et des karakols ou crécelles en fer des nègres. Un charivari monte et descend cette rue de flammes vives, dégénère en vertige, se tord en ondulations spasmatiques, délirantes. Les costumes bariolés moutonnent, les voix s'appellent en cris gutturaux, sauvages. Des yeux vifs et hardis regardent, des bouches gaies montrent des dents blanches. Les peuples du désert et des villes s'y coudoient, noirs d'ébène et blond pâle, en cette tour de Babel nouvelle : Soudan, Tripolitaine, Berbérie, Kabylie, Maroc, Algérie, Abyssinie, Égypte, Turcs et Espagnols, Maltais et Siciliens, touristes anglais à baedeckers et officiers de zouaves. Et voici que, dans cet étourdissant bariolage d'hommes de toutes couleurs et dialectes, deux ou trois ombres de femmes , des Mauresques couvertes du haïck et du voile, se glissent furtives le long des maisons, où elles s'évanouissent comme des fantômes vagues.
On va d'une boutique à l'autre. De petits Arabes aux mines curieuses, éveillées, aux regards jolis, tout de jais noir, s'écrasent chez un montreur de marionnettes. Ils battent des mains, poussent des cris, trépignent quand l'une d'elles se disloque successivement en ses parties : bras, jambes, tête, corps, devenues autant de nonnes frêles, tournant la ronde.
De jeunes Orientaux, aux gerbes de fleurs passées aux oreilles ou sous leurs chechias, sont accroupis près de belles fatmas juives, roses, bleues, vert tendre, saumon, qui dansent deux par deux d'un mouvement harmonieux, lascif, se tenant, se quittant, s'enlaçant, se fuyant, se rappelant, faisant sauter avec des rires de tout leur corps les singulières breloques à glands et a franges pailletées qui leur bossellent le ventre.
Dans la rue, des mains vous tirent les vêtements, des voix crient : « Karaguouz ! Karaguouz ! Entrez ! »
On entre. Un long couloir aux banquettes couvertes de tresses. Au fond, un verre dépoli formant scène, éclairé derrière d'une seule bougie en plein milieu. Près de cette scène, des enfants, plus jolis encore, plus fins que ceux des marionnettes, attentifs à ce qui va se passer. Soudain, une ombre chinoise descend du haut du verre, et le phénoménal Karaguouz apparaît.
— « Hi !.. Hi !... » font les purs petits Arabes,tordus d'un rire fou devant l'obscène bonhomme.
Mais voici Karaguouz, lui-même, qui parle :
« Je me marie. Je vais envoyer ma femme au bain... Ah ! patron du bain, tu causes a l'oreille de ma femme ? Qu'êtes-vous donc l'un a l'autre ?... Ah ! Ça !... vous seriez-vous... moqués de moi avant la noce ?... Attends, que je me venge furieusement sur toi, patron du bain !... quel est ce soldat maintenant ?... Janissaire !... janissaire. Un Juif encore par dessus le marché!... C'est le comble !... Chien de Juif, tu paieras pour les autres, et avec quelle batte tu vas l'apprendre !...»
Corps-à-corps inouï entre Karaguouz et le Juif, mouvement frénétique, saccadé, coup de crachat final intraduisible. Les assistants exhilarent ; les purs petits Arabes, maintenant tout près, tout près, caressent de leurs regards d'innocence immaculée, de candeur les deux immondes pantins pâmés, tombés au bord du verre.
Et c'est de nouvelles danses, danses d'identiques idoles, parées comme des châsses, aux vestes et aux seraouels flambants de soies et d'ors. Danses enragées d'Aïssaouas a longs burnous, a capuchons dressés sur la tête, en bonnet d’évêque, se tortillant ridiculement, désespérément des hanches, se renversant, cataleptiques, en arrière. Danses mystérieuses, perverses et comme sacrées de jeunes garçons du Fezzan. Ils bougent a peine. Leurs yeux vivent. On dirait qu'ils dansent avec leurs yeux. Et des chameaux, des chevaux dansent a leur tour, faux chameaux prodigieux, faux chevaux de fantasias, ruant, mordant, galopant, caracolant, a la plus grande joie des spectateurs, en des cavaliers seuls éperdus.
On sert d'âpres citronnades, limonades, orangeades, cafés aux épaisseurs de sirop, drogs ou purées de gingembre et de graisse, sucrés de sucre en poudre, emporteurs de bouche.
De temps a autre, une voiture aux rideaux rouges, baissés et flottants, fend lentement la foule. On aperçoit des formes rondes, trop grasses, de Juives, bonnets pointus, yeux luisants, voiles qui s'envolent.
Peu à peu, la nuit s'avance. Le tapage infernal des boutiques persiste ; la foule décroît, les promeneurs deviennent plus rares. Au bas de Bab-Souika, près de la rue de la Tolérance (!), des négresses, à travers les fentes lumineuses de portes, font des signes. Des Arabes drapés parlementent avec elles. Ils se disputent. Cris stridents, furieux, insultes, batailles. Les négresses referment les portes, brutalement, telles des gifles sur des désirs.
C'est la dernière nuit de Ramadan que se clôt la fête nocturne, particulièrement bizarre, exaspérée et obscène d'Alfa-Houin. Le lendemain, c'est l'Aïd, la Pâques, fête de jour, de tranquillité, de douceur.
Dès le lever du soleil, de tous les coins de Tunis et des environs, de gaies salves de coups de canon partent. Une vraie débauche de coups de canon dans le soleil. Les Arabes, en souliers neufs, s'embrassent de même que l'on s'embrasse au jour de l'an chez nous. D'autres se serrent la main, ramènent leurs doigts à leurs bouches, faisant le simulacre de les baiser. C'est surtout la fête des enfants. Les voilà seuls, sans parents, abandonnés à eux-mêmes dans leurs superbes vêtements, burnous éclatants, gandouras de couleurs tendres, chechias a longs glands, vestes brodées d'or, culottes bouffantes, les voila qui courent la ville en liberté, fous de joie, fiers de commander, de payer, ivres de vivre. Ils montent deux, trois ensemble, sans selle, sans étriers, sur un cheval qu'ils lancent au triple galop, fouettent a tour de bras les petits ânes tunisiens qui les portent, s'entassent en des charrettes où ils chantent en chœur, balancent leurs tètes jolies, sourient du sourire des bienheureux. De vraies charrettes de fleurs vivantes, ces charrettes d'enfants arabes que l'on rencontre le jour de l'Aïd. « Barra ! — Fissa ! — Baiek ! » Roulez, charrettes d'enfants fleurs ; trottez, bourricots, mules et chevaux ! En route encore pour la fête d'Alfa-Houin !
Dans ce jour de douceur, où les enfants crient au ciel leur joie, j'ai vu un autre enfant, plus grand, dans une rue solitaire, tenir entre ses bras une frêle, très frêle jeune fille qu'il embrassait. Et, comme je m'approchais sans que ni l'un ni l'autre m'eussent entendu venir, je me suis aperçu que c'était à un masque sombre, à un masque impénétrable que l'enfant disait son amour, au terrible masque de la Mort Noire, sous lequel filles et femmes de Tunis ensevelissent leurs yeux d'ardeur, leur secrète et captivante beauté.
Maurice Beaubourg in Gil Blas, 7 Avril 1895.