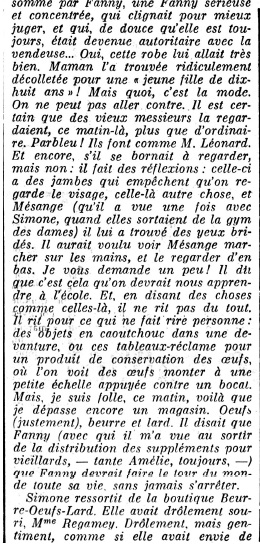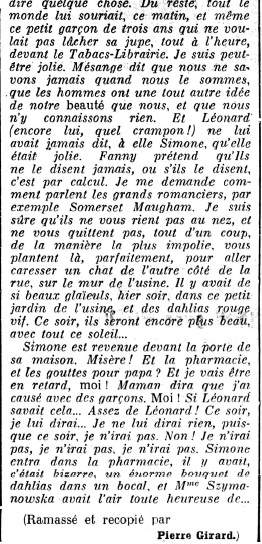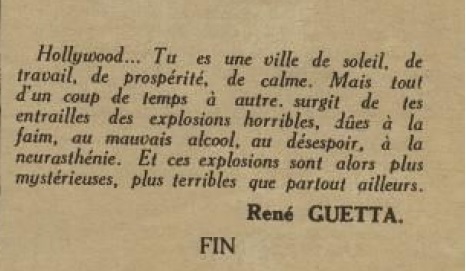Publiée en 1906 pour la première fois en volume, la nouvelle de l'humoriste F. Anstey, Why I Have Given Up Writing Novels, sera traduite par Louis Labat dans Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche du 28 novembre 1908. Deux ans plus tard, elle est reprise par Michel Epuy dans l'Anthologie des humoristes anglais et américains. Le 17 décembre 1928, le journaliste Paul Achard publie dans Comoedia un article intitulé : Pirandello pour écrire «Six personnages» s'est-il inspiré d'une nouvelle de F. Anstey ?Il y accuse, à demi mot, le dramaturge italien de plagiat (le journal publiera la nouvelle). Le 22 décembre, Comoedia publie une lettre de Benjamin Crémieux, traducteur de Pirandello levant toute ambiguité à ce sujet : L'idée des personnages échappant à leur auteur se trouve déjà dans une nouvelle de Pirandello antérieure à celle d'Anstey.
Au delà de cette polémique le texte d'Anstey, qui se veut avant tout parodique, ne manque pas de charme. On notera avec amusement que l'auteur-narrateur se défend aussi de l'accusation de plagiat...
Je n'ai offert au monde qu'une œuvre d'imagination, et déjà pourtant j'en ai pris la résolution, irrévocable : mon premier roman sera mon dernier. Une telle décision a quelque chose d'assez insolite pour que je croie le public en droit de connaître les circonstances qui me l'ont imposée.
Ce n'est pas, disons-le tout de suite, que ma Soupe fatale (Bellows et Bohmer, édit., 6 sh.) fût, à nuls égards, un insuccès. Loin de là. Un critique littéraire aussi autorisé que Toney Tosh signala mon livre comme « le roman de la semaine » ; le Clacton Courier et la Peebles Post lui consacrèrent en même temps deux notices presque bassement flatteuses ; la Giggleswisck Gazette déclara qu'il aiderait à passer une demi-heure dont on n'aurait pas un meilleur emploi. J'ai gardé les coupures de ces articles, et de bien d'autres semblables, pour le cas où j'aurais à prouver mes assertions. Mieux encore, je sais de mes amis qui, pour se procurer l'ouvrage, coururent les cabinets de lecture : on leur répondit invariablement qu'il était dehors. J'ai donc tout lieu de prévoir que les comptes de mes éditeurs, quand ils me seront fournis, constitueront un document péremptoire.
A vrai dire, je n'avais jamais douté, des le principe, que le public n'éprouvât, à lire la Soupe fatale, le même frisson que j'avais ressenti, moi, à l'écrire. L'un après l'autre, les chapitres coulaient comme lave de ma plume ardente. Une merveilleuse force créatrice se révélait, qui, jusque-là, gisait en moi, profonde et secrète. Athènè, dit-on dans le Dictionnaire classique, avait jailli en armes du cerveau de Jupiter. Ainsi mes personnages jaillissaient de mon cerveau, mais tous si débordants de vie que je n'étais maître ni de leurs propos ni de leurs gestes, et que je devais me borner à raconter, avec une admiration qui me mettait hors d'haleine.
C'est là, je le sais, un fait commun d'expérience chez les romanciers qui possèdent le don sans prix de l'invention. Mais je ne crains pas de dire que les conséquences en furent, dans mon cas, assez exceptionnelles.
Ici, quelques détails s'imposent. Je suis un homme d'étude. Je pratique régulièrement les lettres. Je jouis d'un revenu fixe. Et j'occupe une villa entre cour et jardin dans un quartier réputé pour l'esprit exclusif de la société qui l'habite j'ai nommé le Haut-Balham. C'est là que je composai la Soupe fatale (dont je corrigeai cependant les épreuves, du moins en grande partie, dans ma résidence temporaire de l'Esplanade de la Marine, à Bognor, Sussex).
Donc, certain soir, peu de temps après la publication de mon livre, je me trouvais dans mon cabinet d'Helicon Lodge, Haut-Balham, quand la sonnette de l'entrée se mit à tinter avec force. L'instant d'après, ma gouvernante m'annonçait qu'un homme qui refusait de donner son nom, mais se prétendait très connu de moi, demandait à m'entretenir.
Je décidai de le recevoir, non sans craindre qu'il se fût déjà sauvé avec les pardessus et les parapluies du vestibule. Mais sitôt qu'il apparut, un simple regard me démontra l'injustice de mes soupçons. Impossible de me méprendre ni sur ce front ouvert au-dessus duquel la chevelure châtain roulait des boucles abondantes, ni cette face lisse et glabre, aux lèvres fermement ciselées,au menton résolu et carré : c'était Cédric, le héros de la Soupe fatale !
Trop énergique de caractère, ainsi que je m'en rendis compte instantanément, pour rester longtemps confiné sous la couverture d'un livre, Cédric avait fait sauter les nœuds de la reliure; et, naturellement, il avait cru devoir à l'auteur de ses jours sa première visite.
Je lui souhaitai une bienvenue cordiale car je ne pouvais me défendre de quelque fierté à son égard. Là-dessus, ayant pris un siège, en face de moi, il se mit à déverser avec enthousiasme dans mon oreille sympathique ses ambitions, ses rêves et ses spéculations de jeune homme.
Il en eut ainsi pour .plusieurs heures. Si bien que je commençai par le suspecter d'égoïsme (pas une fois il ne mentionna la Soupe fatale !) pour finir par le trouver incommensurablement ennuyeux. Au bout du compte, j'eus à lui laisser entendre que j'avais laissé passer l'heure habituelle de m'aller coucher et que je ne devais pas l'empêcher plus longtemps de rentrer chez lui. Sur quoi j'appris qu'il n'avait pas de chez lui, pas de ressources, et que c'était la raison de sa démarche.
Je regrettai à ce moment de ne l'avoir pas, dans mon roman, pourvu d'une occupation régulière, ou tout au moins d'une vocation, ce qui, pratiquement, ne m'eût rien coûté. Mais une réserve d'artiste, excessive, je l'avoue, m'avait mis en garde contre ces détails prosaïques. Il en résulta que je dus lui abandonner la chambre et le cabinet d'ami jusqu'au jour où il trouverait un emploi quelconque : Ce jour-là n'arriva jamais.
Le jour suivant, une vieille dame, avec des boucles de neige et des joues de pomme d'hiver, m'arriva dans une voiture à galerie qu'elle me laissa le soin de payer. C'était la mère de Cédric. J'aurais dû me douter qu'elle ne supporterait pas longtemps l'absence de son fils car j'avais insisté, dans le livre, sur sa dévotion maternelle. Évidemment, je n'avais rien à faire que lui céder ma chambre. Et je me réfugiai, avec un lit pliant, dans le cabinet de, toilette. Mais je n'occupai même pas effectivement 'cette pièce ; car il se produisit dans l'après-midi une nouvelle arrivée : celle d'une vieille domestique de la famille, nommée Marthe, qui, avec ou sans gages, entendait ne pas quitter sa maîtresse. Comme la vieille dame aimait l'avoir à portée d'appel, force me fut de ̃donner à Marthe le cabinet de toilette et j'allai dormir d'un sommeil agité dans la salle de bain. J'avais, en écrivant le livre, montré une complaisance particulière pour le personnage de Marthe ; je l'avais faite rude et bizarre, mais douée d'un cœur d'or. Elle parlait un dialecte à forte saveur de terroir, qui fondait l'accent du Dorset et celui du Lincolnshire, en y mêlant une pointe de Suffolk. Je n'affirmerais pas que moi-même j'en comprisse toujours le sens. Elle avait une exclamation caractéristique : Mes jolis minets ! qui, imprimée, m'avait paru originale et drôle. Dans la vie réelle, elle ne tarda pas à devenir fatigante. Mais je crois bien qu'à présent Marthe en abusait.
La mère de Cédric, elle, avait une manie : elle faisait asseoir son fils à ses genoux et, d'une main que le temps avait attendrie et creusée de fossettes, elle lissait les mèches rebelles au front du jeune homme. Ce manège, gentil et touchant au début, finit par me donner sur les nerfs. De même l'habitude de Cédric de toujours appeler sa mère : « Mère mienne » Expression parfaitement correcte sans doute et que j'avais forgée moi-même à son usage mais l'accent qu'il y mettait ne me plaisait pas.
Cependant, j'étais en train de m'accoutumer à Cédric, à sa mère, à. leur domestique, quand Yolande survint à l'improviste. Yolande, on voudra bien s'en souvenir, était l'héroïne de la Soupe fatale. La pauvre enfant n'avait ni feu ni lieu. Responsable de son existence, je ne pouvais lui refuser un abri, alors surtout que la mère de Cédric s'offrait généreusement à partager avec elle ma chambre. Nous voilà donc tous là formant, pour ainsi parler, une bien heureuse famille : du moins, une famille que rien n'eût empêchée d'être: heureuse si Yolande eût manifesté l'ombre de sens commun. Elle provoquait l'enchantement et l'adoration, sans quoi elle n'eût pas été de mes héroïnes; elle avait une façon très malicieuse de lever son index fuselé, et il n'y eût, quelque temps, rien de plus charmant que ce geste : mais, avec toute sa douceur et sa grâce, elle ne laissait pas d'être parfois un peu agaçante. Elle avait positivement du génie pour entendre à l'envers les choses les plus simples et pour agir en conséquence avec une irréflexion qui frisait la niaiserie.
Par exemple, elle aimait Cédric à la folie et lui portait un dévouement passionné. Cherchait-il à se déclarer, aussitôt, par le jeu d'une imagination pervertie, elle s'avisait qu'il allait lui apprendre son engagement vis-à-vis d'une autre, et qu'elle avait, elle, l'impérieux devoir de dissimuler ses sentiments sous un masque d'indifférence et de dédain. C'était parfait dans le livre, car le malentendu qui séparait les amoureux n'eût pu, sans cela, durer le nombre de chapitres nécessaire. Mais je ne me serais jamais attendu à ce que, dans la vie réelle, elle lui griffonnât chaque fois un billet formel d'adieu et quittât pour jamais la maison ! Il m'en coûta toute une petite fortune pour la faire rechercher par la police.
Remarquez, d'ailleurs, que je n'ai pas moins à blâmer Cédric. Il s'exprimait, inévitablement, en des termes d'une ambiguïté bien faite pour entretenir le malentendu, et sa modestie excessive l'empêchait de croire qu'il pût inspirer à Yolande un autre sentiment que celui de la répulsion,. Il passait les nuits à s'en lamenter près de moi, et peu s'en fallut qu'il ne me tuât par manque de sommeil. Mais rien de ce que je lui pouvais dire ne lui eût démontré la gratuité de son désespoir. Comme si, parbleu ! je n'avais pas connu l'état d'âme de mon héroïne !
Je l'avoue à regret : en dépit de son front spacieux, de ses fortes mâchoires, et du fait que je l'avais, dans mon roman, doté d'une intelligence fort supérieure à la moyenne, Cédric n'était, sur bien des points, que le type le plus exaspérant du jeune imbécile. Et cela, bien que j'eusse expressément spécifié dans mon livre qu'il avait reçu, à l'école publique et dans l'université, une éducation libérale dont j'avais moi-même ignoré les bienfaits ! Il manquait d'une armature intérieure, au point de ne pouvoir se soutenir dans aucune démarche de la vie.
Je croyais notre petite société à peu près au complet : mais elle se trouva bientôt accrue d'un nouveau membre en la personne du vieux M. Deedes, le très respectable avoué de la famille dans la Soupe fatale. Un trait singularisait M. Deedes : il n'émettait jamais une opinion juridique sans essuyer d'abord ses lunettes et renifler bruyamment pour cacher son émotion. M. Deedes n'était pas très ferré sur la loi ce qui ne doit guère surprendre, étant donné que moi-même je ne la connaissais pas du tout. Et j'avais, toujours par une déplorable réserve d'artiste, négligé délibérément de lui assigner une étude dans un quartier déterminé.
Aussi venait-il chez moi et il m'était difficile d'empêcher qu'il n'utilisât pour ses besoins professionnels la petite salle à manger, encore que les boites d'étain laqué, pleines de minutes et de parchemins poudreux, qui constituaient, si je puis dire, son fonds de commerce, parussent peu congruentes à ce milieu. Ai-je noté que mon héroïne l'appelait couramment « Daddy » Deedes ?- Je le note.
Tout compte fait, je ne pouvais, je le confesse, réprimer en moi un sentiment d'orgueil. Une aventure aussi unique avait, certes, de quoi grandir un auteur dans sa propre estime. Sans m'y appliquer, sans en avoir conscience dans le moment, j'avais créé tout un lot de personnages romanesques, si réels, si effectifs, qu'au sens littéral du mot ils vivaient !
Le seul, inconvénient que je pusse voir à cette prodigieuse fécondité mentale, c'était que, littéralement aussi, ils vivaient de moi.
L'aiguille marquait l'heure ou tous les désagréments subis m'allaient sembler petits, comparés à ceux qui m'attendaient encore ! Une période était proche où l'on pourrait à peine dire que les ennuis causés par ma trop fertile imagination eussent jusque-là commencé !
Personnellement, je daterais cette période de l'instant funeste où Desmond M'Avelly franchit pour la première fois mon seuil. M'Avelly, ai-je besoin de le rappeler au lecteur ? était le traître de la Soupe fatale ; et la modestie d'auteur ne saurait m'aveugler sur le fait que, pour un traître, c'en était un diablement réussi.
Il arriva dans la puissante automobile dont je l'avais pourvu pour les desseins du drame. Ôtant son masque à grosses lunettes et son manteau de fourrure, il se révéla sous un habit de coupe irréprochable et tel que le salon s'indiquait comme la seule place propre à le recevoir. Je mis donc le salon à sa disposition, et il y passa le jour à griller d'innombrables cigarettes, tout en brouillant:les fils de ses infernales trames ! Cependant, aux heures des repas, il rejoignit les autres pensionnaires de mon board, car, pratiquement, je me trouvais tenir un véritable boarding-house, à ceci près que mes pensionnaires n'ayant, ni les uns ni les autres, aucuns moyens visibles d'existence, je ne tirais de l'affaire aucuns notables profits.
Je le vis avec peine circonvenir entièrement la mère de mon héros. Elle s'obstinait il considérer M'Avelly comme un homme d'excellents principes, victime d'un cruel malentendu. Je n'eus de désaccord sérieux avec la vieille dame que le jour où je m'aventurai à la prévenir qu'il pouvait bien être tout différent de ce qu'il semblait. Sans doute, puisqu'il ne m'était pas permis de justifier ma méfiance, je n'eusse fait que sage de me tenir en paix. Quant à mon héros, dont la niaiserie dépassait véritablement toutes mes prévisions, il subit de prime abord l'ascendant de M'Avellv et son charme néfaste. La moindre attention que lui accordait cet homme le flattait absurdement.
Il n'en était pas de même pour Yolande. Fidèle, je le dis avec orgueil, à la conception qui m'avait fait incarner en elle la parfaite ingénuité de la jeune fille anglaise, elle se dérobait d'instinct aux insidieuses avances du traître. Il s'en vengea, comme un traître le devait faire, en travaillant venimeusement contre elle l'esprit de, son amoureux. Comment il s'y prit au juste, hors de ma présence, je l'ignore; mais Cédric se mit bientôt à la traiter avec une froideur marquée, sinon avec une réelle aversion. Il y eut alors une période où elle déserta fréquemment mon toit, bien décidée à en finir par le suicide avec son désespoir.
L'honnête Marthe ne pouvait, comme elle le déclarait avec franchise, souffrir M'Avelly : il adoptait vis-à-vis d'elle un ton de politesse ironique forcément intolérable pour une personne de sa condition et d'un âge aussi respectable. Je me serais senti plus tranquille si j'avais su exactement ce qu'il méditait durant les longues heures qu'il passait tout seul, dans mon salon. C'est qu'aussi bien, dans le roman, je laissais entendre - simplement pour l'effet, car cela ne tenait point à l'intrigue, - que quand d'autres soins, ne l'occupaient pas il était en voie de devenir un anarchiste de marque. L'idée ne me souriait guère qu'à ses moments perdus il fabriquait peut-être des bombes dans le chiffonnier !
Sur ces entrefaites, un homme d'âge mûr, portant des lunettes bleues, se présenta chez moi. Il m'exposa qu'il était infirme, qu'il avait un cobra tout à fait inoffensif auquel il tenait beaucoup, qu'il jouait avec passion de l'accordéon et s'adonnait au haschich après quoi il me demanda de le prendre chez moi comme pensionnaire, moyennant rétribution. J'y consentis avec un soulagement indicible, car j'avais reconnu tout de suite que cet homme ne pouvait être que mon grand - mais excentrique - amateur détective Rumsey Prole. Quelques critiques ont prétendu trouver à mon personnage des ressemblances avec certain héros de sir Conan Doyle. Tout ce que j'en peux dire, c'est qu'une telle ressemblance, si elle existe, n'a rien que d'accidentel. Rumsey Prole est une création de tous points originale, spontanément issue de mon imagination. Ses méthodes, au surplus, diffèrent absolument de celles de son rival spécialiste. Mais je puis me permettre, j'espère, d'ignorer ces chicanes.
Prole dans la place, je me sentais plus en sûreté. Je lui aménageai sous les toits un petit recoin commode pour s'y distraire avec son cobra, jouer de l'accordéon ou mâcher du haschich tout son content. Je montais fréquemment le consulter et le trouvais d'ordinaire absorbé dans la lecture d'Euclide, qu'il prétendait plus amusant et mieux illustré que beaucoup de magazines en vogue. Je le dis à regret, il semblait n'attacher que très peu d'importance à mes soupçons sur M'Avelly, et il en usait envers moi avec une brusquerie que, si je l'avais moins connu, j'aurais prise pour grossière et offensante. Mais c'était pour moi une grande satisfaction que de l'avoir. Son vigoureux esprit était, je le savais, constamment - ou presque constamment - à l'œuvre; et sa facilité à débrouiller, précédemment, le mystère compliqué de la Soupe fatale semblait me garantir qu'il saurait faire échec aux diaboliques imaginations de M'Avelly.
Comment donc la chose arriva-t-elle ? Je ne me l'explique pas. Peut-être Prole prit-il trop de haschich... Toujours il y a que M'Avelly tenta de perpétrer son crime - quel qu'il fût, - car je n'en ai jamais bien précisé le caractère : je sus toutefois par l'inspecteur Chugg (un autre de mes personnages, à qui je n'avais pas cru devoir prêter un éclat excessif) qu'il s'agissait de quelque chose comme d'un fait de baraterie, et que le cas était pendable. Avec une astuce vraiment satanique, M'Avelly s'était arrangé pour faire tomber les soupçons sur l'innocent et malheureux Cédric. Celui-ci, persuadé de son côté, quoique pour des motifs bien insuffisants, qu'Yolande était coupable, prit noblement les charges à son compte. J'y aurais dû m'attendre : il avait fait de même dans le livre. Naturellement, Yolande se méprit sur le mobile qui animait Cédric, et l'honnête jeune fille s'éloigna d'un amoureux qui confessait le crime de baraterie. Mais je ne laissai pas d'être surpris quand l'inspecteur Chugg les arrêta tous deux et après les avoir soumis, en présence l'un de l'autre, à un minutieux interrogatoire, les prévint que toutes leurs déclarations seraient consignées par écrit et produites contre eux aux débats.
J'allais protester avec indignation et ne cachai pas ma joie quand, ayant vidé sa boite de haschich, achevé le premier livre d'Euclide et charmé son cobra jusqu'à l'engourdissement comateux en lui jouant tous les airs de son répertoire, Rumsey Prole vint enfin à la rescousse.
Cet homme merveilleux, par une série d'ingénieuses déductions, rien qu'à consulter des cendres de cigarettes, des feuilles de thé, un billet de tram périmé, un farthing marqué, des atomes de poussière, toutes choses que son œil exercé avait découvertes sur le tapis, prouva de façon évidente que le coupable n'était autre que moi-même !
Cette révélation, positivement, me frappa comme la foudre. Jusqu'à cet instant critique, j'aurais juré que j'étais innocent ! Et je connus une minute amère quand Cédric, quand Yolande, s'étant rendu leur foi réciproque et s'avouant convaincus de ma culpabilité, m'adjurèrent, en termes émouvants, de ne pas permettre qu'une tache si noire souillât leurs jeunes existences, mais de tout confesser et de m'en remettre à la clémence du Ciel ! Je les adjurai à mon tour de n'être pas une paire de jeunes idiots. Force m'était pourtant de reconnaître que si les autres gens ne voulaient pas mieux entendre à la raison, je me trouvais dans une situation plutôt difficile. En fait, c'était tout uniment la potence que je voyais se dresser devant moi ! Dieu merci, à la douzième heure, un sauveur se présenta en la personne de la bonne vieille Marthe ,qui, parle plus pur des hasards, se souvint qu'il existait, dans un pupitre à garnitures de cuivre appartenant à sa maîtresse, certains documents, de nature peut-être, à éclairer l'affaire. Ces documents, tirés au jour, furent soumis au solicitor de la famille, M. Deedes. Il les parcourut anxieusement, ses besicles sur le nez, au milieu d'un silence prolongé et dramatique. A la fin, ayant essuyé ses verres et reniflé plus bruyamment que jamais, il déclara, d'une voix étranglée par l'émotion, que ces papiers, autant qu'il les pouvait interpréter, non seulement démontraient mon innocence et incriminaient M'Avelly (que j'avais soupçonné dès le principe), mais établissaient les droits de Cédric à une pairie tombée en déshérence et identifiaient en Yolande l'héritière longtemps recherchée d'un millionnaire sud-africain, récemment mort intestat, qui lui laissait une rente de dix mille livres, avec une résidence princière dans Park Lane !
Ce fut vraiment pour quelque chose que le brave Deedes trompeta cette fois ! Je n'aurais jamais trouvé pareille issue pour sortir du labyrinthe où nous étions tous inextricablement engagés Et cela montre à quel degré prodigieux les héros d'un roman sont susceptibles de développer leur individualité quand on la leur a d'abord imprimée avec assez de force !
Mon récit touche à son terme. M'Avelly, fredonnant négligemment un refrain; mais murmurant d'horribles imprécations au-dedans de lui-même, s'était déjà soustrait au bras vigoureux de la loi ; le plus tranquillement du monde, il était sorti pour toujours de la maison - et de nos vies. Rumsey Prole me serra chaudement les mains, eu me faisant remarquer que le résultat répondait de tous points à ses calculs. Puis, il fit un paquet du cobra et de l'accordéon et me quitta pour aller renouveler sa provision de haschich avant d'entreprendre de nouvelles investigations dans un cas qui demandait son assistance.
Cédric et sa mère, avec la fidèle Marthe, partirent pour réclamer la pairie vacante et occuper le palais de Park Lane. Je ne tentai pas de les retenir. Restait le brave M..Deedes. Ne pouvant permettre qu'il fit plus longtemps son métier de solicitor dans ma salle à manger, je lui louai dans Bedford Row un office où il eût tout loisir de frotter ses lunettes et de souffler du nez sans être vu ni entendu de personne, car j'ai peine à croire qu'aucun client de bon sens l'aille jamais consulter. Je sais, quant à moi, que je n'en aurai garde.
Sans doute en ai-je dit assez pour mettre mon aimable lecteur à même de comprendre comment et pourquoi, en dépit - sinon à cause - du succès sans précédent qui couronna mon premier et très modeste effort littéraire, j'ai décidé qu'il n'y avait pas lieu de le renouveler.
Les événements d'où je sors m'ont, en effet, si gravement impressionné, que mon docteur m'a prescrit le repos absolu, et que je fais en ce moment un séjour, d'ailleurs temporaire, dans un sanatorium.
Le directeur médical de l'établissement est, je le vois, bien qu'il tâche de n'en laisser rien paraître, enclin à considérer mon étrange aventure comme plus ou moins imaginaire.
J'aime à penser néanmoins qu'en la voyant imprimée il se convaincra qu'une déclaration aussi franche, aussi exempte d'exagération, ne' peut guère procéder d'une fantaisie de malade. Et s'il doute encore, ce sera tout un pour moi.
F- Anstey. Traduit de l'anglais par Louis Labat.