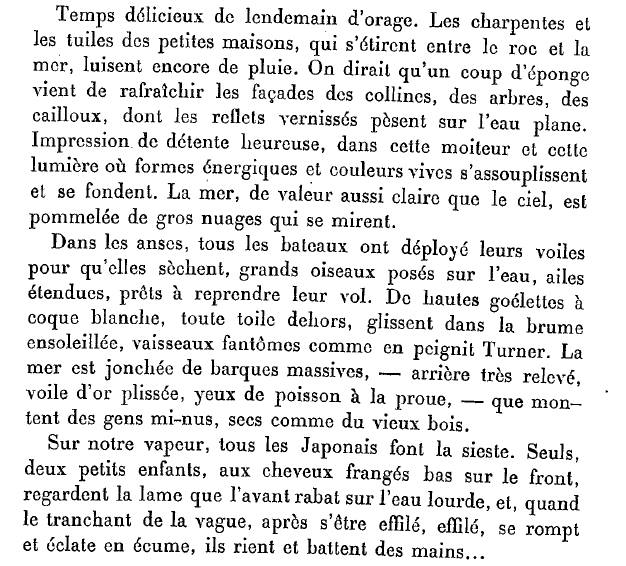La part essentielle prise par Bernard Lazare (1865-1903) dans le combat en faveur de Dreyfus a fini par occulter la dimension purement littéraire de son oeuvre. On lui doit en effet une série de contes et nouvelles publiée en volume en 1892 et 1897, textes marqués par l’esprit symboliste de cette fin de siècle. Le conte choisi ici (publié en 1892 dans (Le Miroir des légendes) l’a été pour ses qualités intrinsèques mais aussi parce qu’il offre la particularité d’annoncer une autre fantaisie christologique au thème similaire, celle de Borges intitulée Trois versions de Judas.
Borges a-t-il lu Bernard Lazare ?
La Gloire de Judas
Que vous-ai donc fait pour être votre élu ?
A. de Vigny
I
En ce temps-là, Quintilla, zélatrice de et prophétesse de Judas, prêchait à Carthage et malgré Tertullien, l'impétueux presbytre, les chrétiens accouraient vers elle et, pour l'entendre, quittaient les églises où la vraie parole était enseignée.
Elle avait élu, pour proclamer la coupable doctrine, une grotte située non loin de la ville, grotte déjà souillée par l'adoration mystérieuse de funèbres dieux abolis. Encore, sur les parois, distinguait-on des caractères inconnus, symboles sans doute cle quelque infernale révélation ou bien témoins de ferveurs déchues ; et, dans le fond, une large table de marbre attestait de redoutables et criminels rites, car le marbre était rouge et le sang des sacrifices antiques l'avait ainsi teint.
Or, ce soir-la était un vénéré anniversaire. Toute la nuit devait être commémoré la mort consentie par l'apôtre que d'entre eux chassèrent les apôtres, la volontaire mort de Judas, celui de Karioth ; et dans la caverne consacrée affluaient les fidèles : femmes long voilées et hommes dissimulés sous le large pan de leurs robes. Sur l'autel marmoréen siégeait Quintilla vêtue de blanc ; des vieillards l'entouraient. Quand la foule silencieuse se fut assise, ils entonnèrent les rituelles louanges et les hymnes coutumiers.
« Loué soit Paul, qu'éclaira la sagesse ! »
Les auditeurs répondirent :
« Paul, apostole et saint sois loué ! »
Les vieillards continuèrent :
« Adorons Paul qui sut tuer Saül comme Jésus abattit Jéhovah. Adorons Paul que la Sophia ravit au ciel. Adorons Paul qui nous guida vers le seul Dieu. Adorons Paul qui nous conduisit à Judas !
- Adorons Paul, » murmurèrent les assistants ; et le long bruissement de leurs invocations se répercuta en échos assourdis dans l'antre.
Il s fit un silence, puis reprit le chœur des ancestrales voix mais plus bas, car le mystère des paroles dites emplissait de frayeur l'âme de ces aïeux :
« Il y a Sophia et il y a Hystéra ! »
Avec de bégaiements trémulants de terreur, les hommes, seuls, répétèrent :
« Il y a Sophia et il y a Hystéra ! »
Le plus âgé des coryphées, étendant les mains, de longues mains pâles et sèches qui semblaient déposer un manteau de silence, dit alors le chant initiateur des ineffables vérités.
« Ceux-là que l'on appelle saints et que renomme le livre mauvais, la Bible, ceux-là qui furent plutôt les faibles et les irrésolus, Hystéra les avait formés. Abel, Iakob, Mosché, race d'esclaves sans cesse oourbés aux pieds du Dieu qui engendra le mal et punit les puissants ; Abel, le père des génuflexions et des vains soupirs ; Iakob et puis Mosché, vils conducteurs d'un vil troupeau. Maudits soient-ils ! car devant le cruel dompteur du monde ils furent lâches !
- Maudits soient-ils ! crièrent les vieillards.
- Ceux-là que l'on nomme méchants et que contemne le livre détestable, la Bible, ceux-là qui furent plutôt les révoltés et les justes, Sophia, éternelle el infaillible, les avait créés. Kain, Nimrod, Dathan, Koré, race de héros sans cesse en lutte contre lui, l`Élohim, favorable à ses humbles laudateurs. Vous tous aussi qui chantiez dans Sedom ou vous réjouissiez dans Ghamora, vous qui insultiez Jéhovah dans Zéboïm et le blasphémiez dans Adama, guerriers et fils des anges, vous qu'inspira Sophia, la souveraine et la mère : gloire à vous, car devant le cruel dompteur du monde vous fûtes forts !
- Gloire à vous ! clama le Peuple en s'agenouillant ! gloire à vous ! »
Les acclamations, répétées par les rochers, roulèrent en vagues de sons éclatants, puis, comme de lointains grondements d'orage, elles s'apaisèrent, se turent, et quand les fidèles prosternés se relevèrent, Quintilla était debout sur l'autel.
« Maintenant, dit-elle, que pieusement soit invoqué le nom du suprême saint, du juste qui subit et accepta la honte pour nous délivrer d'Hystéra et de Jéhovah, du martyr qui choisit la mort infamante et hideuse : le nom vénéré du divin Judas.
- Béni soit Judas ! »
Quintilla prit sur le marbre un parchemin et dressant le rouleau, telle dans la synagogue s'élève la loi sacrée :
« Voici l'Évangile ! Celui qui fut révélé à Paul, l'apôtre au cœur bienveillant, et qu'il voulut écrire lui-même pour nous tirer du l'erreur Que son nom soit béni à cause de cela. »
Pareille aux vagues d'un calme lac secoué par une tempête imprévue, la cohue des auditeurs se rua vers la prophétesse, et tous tendaient la mains pour toucher le livre dont le seul contact purifiait et instruisait. Mais les vieillards les arrêtèrent et l'un d'eux cria :
« Écoutez ! »
Ayant déployé la peau de chevreau, Quintilla lut, psalmodiant les mots sur une mélopée rythmique et bizarre, évocatrice d'intenses visions.
II
« Or le fils de Sophia, le vainqueur et le maître de Jéhovah, Jésus, avait souffert en sa chair. Les bras étendus, bénissant le monde libéré, il était mort : il avait ressuscité le troisième jour et, près de sa mère, il trônait désormais.
Les disciples survivaient, épendant la doctrine, comme un vin tiède et doux hors des amphores pleines. Paul très grand et Pierre vénérable ; Luc et Marc, Mathieu et Jean, aèdes du Seigneur, et Mathias qui remplaçait Judas le Saint, car les destins se devaient accomplir.
« Depuis que les deniers consacrés, les deniers frappés par Ninus, le roi des Àssyriens, avaient chu dans sa main, scellant. l'œuvre, l'élu de Karioth, criminel ineffable, errait dans les rues de Icrouschalaïm, en proie aux insultes et aux coups. Les fidèles de Christ ramassaient. pour les lui jeter au visage, les pierres qu'à la voix divine avaient laissé tomber les juges de la femme adultère, et Pilate et Caïphe eux-mêmes se détournaient de lui avec mépris. Tous, les pêcheurs galiléens, frères de ceux-là qui abandonnaient leurs filets aux grèves des mers paisibles pour suivre le maître cher, et les marchands qui, désormais vendaient en paix sous les portiques du temple, tous refusaient son obole, craignant de toucher, eux aussi, le prix de l'adorable sang. Seul, un pharisien impavide l'accueillit un jour le Bienheureux et, pour la somme fatale, il lui vendit son champ : le champ du potier.
« Alors, n'ayant pas compris quelles inflexibles lois avaient guidé son âme, en horreur à lui-même, Judas, le traître vénérable, se réfugia dans l'enclos de la vigne qu'ombrageaient d'épais figuiers. Et ce lieu. sacré maintenant, Hakel-Dama, la terre sanglante que de pieuses lèvres iront baiser, s'étalait au midi de la ville, au-delà de la vallée de Hinnom, et le mont du Mauvais Conseil le dominait.
« Là, Judas vivait solitaire, se repentant de ce qu'il croyait être le mal et gémissant de son imaginaire faute. Il se nourrissait de racines et de figues, buvait l'eau tépide et croupie des mares, couchait sur le sol caillouteux que baignaient ses larmes. et il implorait silencieusement le Dieu qu'il avait dressé sur le Golgotha.
« Un soir, assis sous les grands arbres, il priait désespérément. Le vent, que parfumait les arômes des collines, éveillait en son cœur meurtri l'écho des divines paraboles ouïes jadis. quand il accompagnait l'0int par les plaines de Judée. Et le lourd silence, qui depuis longtemps scellait ses lèvres, se rompit enfin, et d'une voix misérable, il cria dans la nuit surprise :
« -J'ai péché en livrant le sang innocent ! »
« Les sanglots soulevaient en spasmes sa gorge ; il frappait sa tête contre les troncs rugueux.
Soudain, une intense lumière l'envahit ; ses yeux, qu'avaient clos les trop épaisses paupières, mettant sur chaque prunelle une chape de plomb, ses yeux se rouvrirent, et, devant lui, il vit un homme qu`il reconnut.. Si souvent, il avait vu cette blanche robe, ce limpide visage, et tant de fois cette bouche s'était ouverte pour des mots amis. Il tendit ses bras tremblants, et frémissant d'angoisse, il demanda :
- « Est-ce toi, Rabbi ? »
« Jésus répondit :
- « C'est moi. »
« Celui qui désespérait se jeta contre terre, et, Christ, qu'à jamais dans les siècles futurs soit béni son nom ! le releva. tendrement. Il le baisa sur le front et lui dit :
- « Judas, ne pleure plus. »
« Judas lui répondit :
- « J'ai levé la main sur toi, Maître, et failli ; pardonne-moi ! »
« De nouveau, le fils de Sophia l'embrassa.
- « le baiser que sous les oliviers, tu me donnas, fit-il, je te le rends, et comme il m'affranchit des chaînes terrestres, qu'il t'affranchisse du remords ! »
« Comme un flot limpide, la paix entra dans l'âme du saint de Karioth, et, Jésus, prenant la main qui avait reçu la libératrice offrande continua :
- « Tu n'as point péché, Judas, tu as accompli l'œuvre. »
- « J'ai gémi, Rabbi ! j'ai pleuré !
- « A présent, réjouis-toi !
- « Mes frères, ceux que tu chérissais, m'ont maudit et chassé !
- « Tu serra béni dans la ciel et tu t'assiéras à ma droite.
- « Quand tu m'as donné le pain, Satan m'a saisi.
- « Il le fallait, tu étais désigné. Déjà, mon prophète Jérémie l'avait annoncé.
- « Pourquoi moi, Seigneur ?
- « Sois fier, Judas ; de tous temps, je t'avais élu. Va, ceux de mon église croient que Jean fut l'apôtre cher, non : l'apôtre aimé ce fut toi, et j'ai chargé ton nom d'opprobre parmi les hommes, il sera sanctifié parmi les bienheureux. Quelques-uns seulement de ceux qui vivront sous ma loi, sauront ta glorieuse destinée. Il faut, pour mon triomphe, que persiste ton ignominie.
- « Maître, dispose du disciple que ta volonté rendit infidèle.
- « Nul ne sera près, de ma mère, accueilli comme toi, Judas, car nul, en sa vie terrestre n'aura amassé plus d'affronts.
- « Maintenant, ils me seront doux.
- « Fils de Ruben, fils de Cyborée, je t'ai voulu courbé sous le poids des fautes, pour qu'au jour des suprêmes révélations l'orgueil des docteurs soit confondu, et ils reconnaîtront qu'un criminel comme une pécheresse travaillèrent plus qu'eux au salut. Quand tu flottais vagissant sur les flots, ma droite protectrice te conduisit au port : quand tu t'enfuis de chez la Reine, je te guidais vers Pilate ; sous le pommier fatale, je dirigeai ta main, qui tua Ruben, ton père, et j'amenai vers toi ta mère Cyborée, dont tu fis ta femme. Le soir où, parricide, incestueux, tu vins, lassé de tes péchés, embrasser mes genoux, je le reçus pour que tu me livrasses. Ne t'ai-je pas dit : « Ce que tu dois faire, fais-le promptement ? » A l'heure voulue, tu vins, toi par qui se devaient avérer les prophéties éternelles, et ton pas en ébranlant les pentes du jardin de douleur, présagea la rédemption prochaine. Elles me furent bonnes tes lèvres effleurant ma joue, et bon ton regard traditeur, et je t'en ai voué un plus tendre amour. Écoute, maintenant, préféré.
- « Parle, Seigneur.
- « J'ai voulu descendre encore en Judée pour calmer tes peines, tes douleurs. Tes larmes me déchiraient, je suis venu les tarir. Mais aucun ne doit savoir de ta bouche les paroles dites. Achève ce que tu as commencé, et que ta fin justifie ta vie.
« Jésus posa sa main, d'un geste bienveillant, sur le tête de Judas, qui se courba et pria.
Quand il se redressa, il était seul dans Hakel-Dama.
Les mots proférés, éternels et immuables flottaient encore dans l'air. Ils retentissaient en l'âme de Judas, purs et beaux, arrachant les voiles qui jusqu'alors avaient enténébré ses esprits. C'était comme une brume qui dissoute, aurait révélé l'immensité d'un étang merveilleux, au fond clair, au rivage tranquille, aux confins inaperçus ; un étang gemmé de larges et solennelles fleurs. Le Très-Saint se ressaisit dans l'infini des âges, il perçut sa prédestination bénie, il entrevit les austères futurs qui lui étaient échus.
- « Que ta fin justifie ta vie, » avait dit le fills de Sophia. Sa vie avait été immonde, il ne pouvait avoir le calme trépas des nabis. Saintement abject, il avait vécu par la crime ; par le crime, il devait périr. « Ne tue pas, » tel était le précepte qui avait encore résonné en Galilée, et le plus effroyable homicide, n'était-ce pas la volontaire immolation de soi-même ? Il comprenait l'ordre fatal. Il était l'holocauste promis au juste holocauste. Il devait accomplir l'ultime, criminelle et méritoire oblation. Le souvenir des souillures passés se répercutait au plus profond de lui-même, tel un chœur suranné de voix mauvaises, appelant la souillure dernière. Il avait porté la main sur Ruben. son père, et sur Cyborée, sa mère, et sur Jésus, son Dieu : il la lèverait sur lui.
« Il marcha vers la cabane lépreuse où gisaient sa cruche ébréchée et ses écuelles d'argile ; il prit une corde de chanvre, il revint vers le haut figuier et se pendit aux branches gémissantes, en prononçant le nom du vendu aimé.
« Des harmonies profondes planaient sur les arbres et des présences divines se révélaient dans le champ sanglant. D'hyalines clartés revêtaient les buissons, des corolles surnaturelles pleuvaient sur la hutte, des parfums subtils traînaient. Et. brusquement, le corps du pendu creva par le milieu et ses entrailles ruisselèrent sur le sol, - il fallait que sa mort fût abominable,- mais son visage ne fut terni d'aucune macule, car il avait touché le visage du Christ. Les Eons assemblés et les Séraphins augustes prirent Judas qu'appelaient les cieux entr'ouverts, et les laboureurs, qui le matin passèrent près d'Hakel-Dama, racontèrent la misérable expiation du traître, de celui de Karioth.
- « Judas, victime chère et désignée, sois béni, toi le libérateur ! »
« Telles sont les choses que la très haute sagesse révéla à Paul, apostole, quand il fut ravi aux resplendissants empyrées, et Paul, mystérieusement, les redit à quelques-uns d'entre les hommes, qui les conservent et les promulguent aux rares appelés. »
Et les secrètes, absolues et essentielles vérités étant énoncées, Quinlilla couvrit son front du lin symbolique et se tut.