samedi 5 mai 2018
La foire du Trône
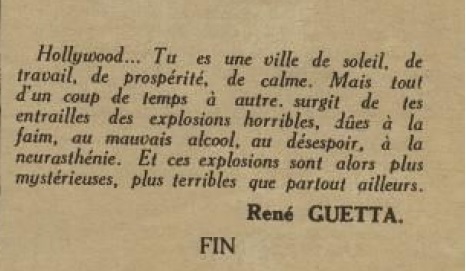
Détective n° 45, 5 septembre 1929.
A la fin des années 20, René Guetta séjourne à Holywood. Il y fréquente les studios et les bas-fonds. Septembre 1929, il donne un long article à Détective et publie chez Plon, Sous le ciel d'Hollywood. Trop près des étoiles où il relate ses rencontres et expériences.
En 31, sur le bateau qui le ramène en Europe, il fait la connaissance de Clara et André Malraux. C'est le début d'une amitié. Sa gouaille, sa fantaisie lui valent le surnom de Toto. Clara Malraux le qualifie de farfelu. Il porte alors à un oeil un bandeau noir, conséquence d'une rixe, qui le fait ressembler à Filochard des Pieds-Nickelés. Il servira de modèle au personnage de Clappique dans La Condition humaine.
Tout au long des années 30, il collabore régulièrement à l'hebdomadaire Marianne. Puis vient la guerre. Juif, il est abrité par Edith Piaf et finira par rejoindre la Corse pour lutter contre l'occupant. La date de sa mort est inconnue.
Mais pour l'instant, nous somme en avril 36. Le fascisme battu par le front populaire titre Marianne. L'heure est à l'espoir et aux autos-tamponneuses
Il pleuvait. Il faisait froid. Il faisait s'ombre. On pataugeait dans la boue.
On avait la figure pâle et le nez mauve. On grelottait. On souhaitait un bon lit bien chaud. Pourtant, on restait là, place de la Nation, au milieu de la Foire du Trône, debout, enchanté, ravi, incapable de se dégager de l'odeur de vanille qui traînait dans l'air, envoûté par les lumières fades, par les cris, par les rires, par la bonne humeur des ombres qui vous encerclaient.
Dès la sortie du triste métro, de magnifiques affiches lumineuses, jaunes et rouges, vous invitaient à quitter les rues sans joie d'alentour pour vous plonger dans la vaste rigolade populaire. On se laissait tenter et là-bas, autant le bistro, aux glaces grises, paraissait mélancolique, autant les étalages de nougat et des marchands de cochons en pain d'épice, nous remplissaient d'aise.
Au milieu des avenues éclairées et somptueuses, des couples d'amoureux marchaient en se serrant très fort les uns contre les autres pour avoir plus chaud. Des militaires épais, lourds, ahuris, allaient par groupes sans se lâcher d'une semelle : un soldat est toujours timide. Six soldats ont du culot pour vingt.
— Allons, les artilleurs, v'nez faire un carton! hurlait les grosses dames des tirs, frisottées et engageantes.
Et des maigres types en chandail, montrant leurs dents vertes, criaient :
— Essayez plutôt vos chances à la lot'rie. C'est pas la nationale! Ici on gagne « tojors » !
Des mers, des vagues de casquettes écoutaient, s'arrêtaient, se levaient, tanguaient.
— Alors, Toto? On y va ?
— Voui, mon dandy. Et j'vais t' gagner une bouteille ed' « bouché ».
Les chapeaux mous, moins nombreux, mais plus élégants, choisissaient de préférence les jeux de force. Quant aux sans-chapeau, ils attendaient dans un coin sombre que passât une quelconque petite demoiselle en cheveux, le nez en l'air, pour sauter dessus gentiment.
— Où qu'vous allez comme ça ? Une bat' petite môme, comme vous, ça doit pas s'balader seule. V'nez dans l'scenic.
La jeune personne refusait, puis acceptait vite, parce que, dans les montagnes russes, on peut se caresser tranquillement, sans en avoir l'air, sans se connaître, rapport aux cahots !
Une animation croissante régnait, sous la pluie fine, devant toutes ces merveilles. On dépensait à toute allure, par vingt sous, ce qu'on possédait, mais cela n'empêchait pas de nager dans la béatitude puisqu'on avait le droit, dans cette atmosphère fausse et clinquante, de voir ou d'entendre sans payer, lorsqu'on était fauché, la voix de Maurice Chevalier ou un air de biguine, sortant des haut-parleurs déchaînés. Cela donnait envie de danser...
Des malins, décoiffés, spécialistes d'un jeu d'adresse, montraient fièrement, aux spectateurs admiratifs, les bouteilles gagnées.
— J'm'en tape pour dix balles de « mousseux » tous les soirs. J'les r'vends après !
Un vieux monsieur, un très vieux monsieur cramoisi, sale et pauvre, pinçait les fesses de toutes les filles qui avaient le malheur de passer près de lui. Sans s'émouvoir, elles se retournaient et, hautaines, disaient :
— S'pèce ed' salaud va !
Puis, frétillantes,. elles s'évanouissaient au milieu de la foule dense.
Mais les balançoires, les tirs, les jeux de massacre, les montagnes russes, les photographes, les cartomanciennes, les marchands de nougat et de pain d'épice, le libraire même qui vendait des dictionnaires Quillet. devaient s'incliner devant le succès des manèges d'automobiles électriques. Pour quarante sous, en effet, on avait le droit de grimper dans une voiture. A un signal donné, on démarrait. On jouissait alors de l'impression délicieuse de conduire sa propre Rolls-Royce — pas moins. Et comme la piste était petite et les RollsRoyce nombreuses, de terribles collisions se produisaient. Des cris s'élevaient. On sautait en l'air. Le volant vous entrait dans le ventre. C'était exquis !
Pour attirer la clientèle masculine, les organisateurs, comme au « Coliséum » faisaient appel à des « taxigirl » — ainsi nommées sans doute parce qu'elle conduisent des autos. Les entraîneuses étaient charmantes et diaboliquement habiles. Au début de la soirée, elles s'installaient dans leur voiture et elles y restaient jusqu'à la fermeture de l'attraction. Toujours il y en avait deux en permanence : une brune et une blonde. La brune, mince, jolie, calme, féroce, travaillait avec sérénité. Elle percutait dans la bagnole des amateurs avec une rage froide et redoutable.
La blonde, très mignonne, conduisait en dédiant des sourires lointains à ceux qu'elle emboutissait. La première fois, elle ne disait rien. La deuxième fois, elle rigolait doucement. La troisième fois, elle demandait discrètement :
— Tu viens chez moi, chéri ? Il fait plus chaud qu'ici !
Il paraît que ces dames avaient des amis fidèles, qui revenaient très souvent les voir.
A minuit, nous avions tout vu, tout senti, tout observé. Nous étions heureux, trempés, morts de fatigue.
Et, pendant que le métro roulait, nous songions, dans un demi-sommeil, à ce Paris que l'on trouve si triste. Que n'obtient-on l'autorisation de fourrer dans chaque quartier, tous les soirs jusqu'à onze heures, des bals en plein air (comme au 14 juillet), des lampions, des orchestres, des camelots, des attractions, des bistros, de manière que tout le monde puisse s'amuser, en sortant du bureau, sans dépenser trois cents francs par tête ! Les comités des fêtes ne rendent heureux — et encore - qu'un minimum de gens.
Rien n'empêche que ces gens continuent à s'amuser entre eux, pour le même prix. Mais, en attendant, il faudrait que les cafés, les musiciens, les commerçants, les femmes, les hommes, puissent profiter de la rue, puissent obtenir des privilèges pour la rue, puissent s'amuser grâce à la rue, puissent animer la rue d'une gaieté sincère et gratuite. Alors, on reverrait non seulement les hommes et les femmes du monde de France, mais les étrangers revenir « faire la foire », tout guillerets, et « guincher » sous les lampions, au son d'une fanfare poétique, dans un Paris transformé dont les rues seraient enfin en joie.
René Guetta in Marianne, 29 avril 1936.
17:31 :: # :: Aucune réponse